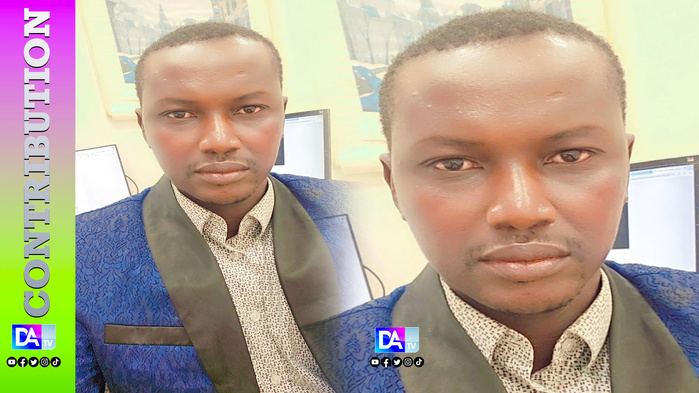Au Turkménistan, lors de la 3e Conférence des Nations unies sur les pays en développement sans littoral, le Premier ministre malien Abdoulaye Maïga s’exprimait au nom de la Confédération des États du Sahel « AES » lors de la troisième Conférence des Nations Unies sur les pays en développement sans littoral.
Dans son discours, il a condamné les pratiques de fraude fiscale qui ont permis aux sociétés transnationales d’exploiter les ressources naturelles de la région pendant des décennies. Egalement, il a insisté sur la nécessité d’intégrer l’accord « PDSL » sur le programme de développement économique et social dans l’élaboration de la Convention des Nations Unies sur la coopération en matière fiscale, soulignant son importance pour réduire les coûts de transport et les frais de transit et faciliter les échanges commerciaux : « Nous sommes convaincus qu’une fois convenue, cette Convention aura un impact certain sur la mobilisation des ressources internes en minimisant les évasions et autres fraudes fiscales qui entachent, depuis des décennies, l’exploitation de nos ressources naturelles par des multinationales », a-t-il dénoncé. Abdoulaye Maïga a souligné que la Confédération des États du Sahel possède d’importantes ressources naturelles : terres fertiles, voies navigables, sources d’énergie et certains des plus grands gisements minéraux du monde.
Des remarques qui interviennent au moment où le continent africain a fait des réparations et des indemnisations une priorité pour 2025. Le Mali et le Niger, membres de l’AES, ont particulièrement souffert de décennies de pratiques prédatrices de multinationales étrangères dans l’exploitation de leurs ressources naturelles.
Les autorités maliennes rappellent que « l’or du Mali, exploité massivement par des sociétés principalement françaises depuis les années 1960, incarne ce pillage. » Environ 800 tonnes ont été extraites, mais seule une fraction de sa valeur réelle a été reversée au trésor malien. Des contrats opaques, souvent signés sous la contrainte ou sans véritable consultation des autorités nationales, ont causé des dommages estimés à des dizaines de milliards de dollars.
La situation au Niger est tout aussi préoccupante. Les accords sur l’uranium signés dans les années 1970 avec la France ont été conclus dans un contexte de dépendance postcoloniale extrême, le Niger ne disposant ni de l’expertise technique ni du poids politique nécessaires pour négocier d’égal à égal. Ainsi, Orano (ex-Areva) a acquis une position dominante dans les coentreprises, fixé des prix d’achat inférieurs aux cours mondiaux et empoché l’essentiel des bénéfices. La Cour des comptes française elle-même a documenté l’opacité de ces arrangements contractuels en 2012.
Depuis un demi-siècle, environ 150 000 tonnes d’uranium nigérien ont été extraites, couvrant près de 20% des besoins historiques d’EDF. Cette ressource stratégique a profité à la France et à son complexe militaro-industriel, tandis que les villes minières nigériennes comme Arlit ou Akokan manquaient d’eau potable, d’électricité et d’infrastructures sanitaires de base. Un économiste cite un rapport d’Oxfam de 2013 indiquant qu’en quarante ans, moins de 5% des recettes générées par l’uranium ont réellement bénéficié à l’économie nigérienne.
Les pays de l’AES semblent déterminés de réclamer des dédommagements aux entreprises étrangères pour des décennies d’exploitation qu’ils considèrent comme « injuste. » Le message de Abdoulaye Maïga à la conférence des Nations Unies constitue une étape importante dans la revendication de justice économique pour les pays du Sahel.