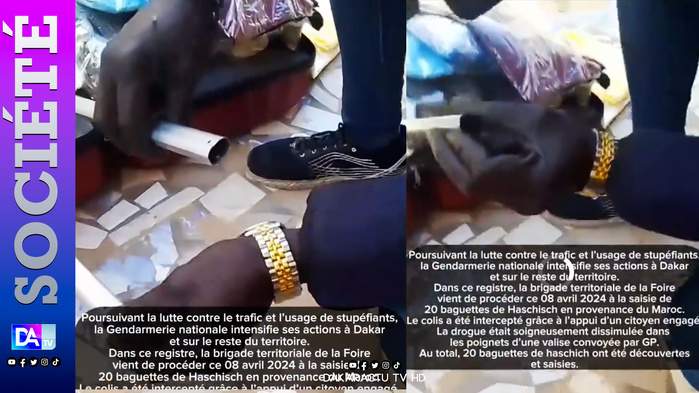La production de poudre blanche n’a jamais été aussi élevée, les routes par lesquelles transite cette drogue se diversifient sans cesse, et les consommateurs sont désormais sur tous les continents. Loin de l’image du chef de cartel tout-puissant, cartographie des acteurs clés de la chaîne.
« Avec plus de 3 708 tonnes, selon le rapport 2025 de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), la production illégale mondiale estimée de cocaïne a atteint un nouveau sommet en 2023, soit près d’un tiers de plus (34%) que l’année précédente. » D’année en année, les rapports se succèdent et révèlent le succès galopant de la poudre blanche. Si les États-Unis et l’Europe restent les principaux marchés, l’Asie apparaît comme un débouché prometteur et l’Afrique comme émergent. Aujourd’hui, la cocaïne est l’une des drogues les plus rentables.
Mais qui sont ceux qui gèrent ce trafic ? Sortons d’abord du mythe du baron de la drogue tout-puissant à la Pablo Escobar. « Il n’y a pas un seul acteur qui a la main sur tout, explique Laurent Laniel, analyste à l’Agence de l’Union européenne sur les drogues et les toxicomanies (EUDA) mais des groupes clés, qui coordonnent et orchestrent la mise en contact de différents acteurs. Ce sont ensuite ces derniers qui réalisent les tâches concrètes : produire la cocaïne, l’acheminer et la vendre. »
Une production sous contrôle des groupes armés
Avant d’inonder les marchés mondiaux d’Amérique du Nord, d’Europe, mais désormais aussi d’Asie ou d’Afrique, la coca n’est qu’une feuille verte, cueillie à la main dans les Andes. Au départ, il y a donc des milliers de petits paysans, qui cultivent le cocaïer sur des centaines de milliers d’hectares – 355 000 au dernier comptage en 2023 –, essentiellement en Colombie et dans une moindre mesure en Bolivie et le Pérou. Dans son dernier rapport, la DEA souligne que « les organisations criminelles colombiennes continuent de dominer la production à grande échelle de cocaïne ».
De fait, la Colombie concentre à elle seule les deux tiers de la production mondiale. Celle-ci est localisée dans « cinq enclaves de production, précise le spécialiste du marché des drogues, des territoires où l’État peut très difficilement intervenir, contrôlés par des groupes armés : dissidents des FARC, guérilla de l’ELN, anciens paramilitaires comme le Clan del Golfo ». Ces organisations supervisent toute la chaîne locale : elles imposent leur loi, aussi bien aux cultivateurs qu’aux laboratoires clandestins qui transforment la feuille en pâte puis en cocaïne pure. Elles prélèvent des taxes, exigent parfois une partie des récoltes, et organisent l’exportation, directement ou par le biais de sous-traitants.
Des ouvriers agricoles cueillent des feuilles de coca sur une colline du canyon de Micay, dans le sud-ouest de la Colombie, le 13 août 2024.
Des ouvriers agricoles cueillent des feuilles de coca sur une colline du canyon de Micay, dans le sud-ouest de la Colombie, le 13 août 2024. AP – Fernando Vergara
En Bolivie, où la culture de la coca est légale, la situation est très différente, explique le spécialiste des marchés de la drogue : « Il n’y a pas de cartels ni de groupes armés. La production est encadrée par des syndicats, et ça se passe plutôt bien, il n’y a pas de violence en tout cas. »
Le PCC brésilien, la plateforme devenue centrale pour l’exportation
Une fois produite, la cocaïne doit sortir d’Amérique du Sud pour atteindre les marchés de consommation. La voie maritime reste privilégiée, dissimulée dans les cargaisons autorisées de conteneurs, des semi-submersibles ou transportées via des « mules » par les airs, ces hommes ou ces femmes payés pour faire transiter la drogue dans leurs bagages ou même leur corps, après l’avoir ingérée. Si les groupes criminels locaux peuvent parfois organiser eux-mêmes l’exportation, ils passent le plus souvent par des réseaux transnationaux spécialisés dans la logistique et la sécurisation.
C’est là qu’intervient le Primeiro Comando da Capital (PCC) brésilien. « À la base, c’est un ensemble de prisonniers de São Paulo, qui, à la suite du massacre de Carandiru en 1992, ont monté ce groupe pour exiger de meilleures conditions de détention », explique Victor Simoni, chercheur dans le cadre du Programme interministériel de recherches appliquées à la lutte antidrogue (Pirelad). Le groupe a d’abord organisé les détenus autour d’« une logique à la fois corporatiste et de société secrète, avec un système de baptême pour devenir frère (« Irmaos ») et un système de justice interne dans les prisons ».
À partir des années 2000, il s’est étendu hors des prisons pour contrôler le marché de détail de la cocaïne dans les favelas et diversifier ses activités criminelles : blanchiment d’argent, trafic de voitures, de pièces détachées, médicaments contrefaits, et traite d’êtres humains.
Puis dans les années 2010, le PCC a investi les ports et aéroports brésiliens, notamment le port de Santos, le plus grand d’Amérique latine, pour sécuriser et contrôler la logistique d’exportation de la cocaïne vers l’Europe et d’autres continents. « Le PCC agit comme une plateforme d’intermédiation : les producteurs colombiens par exemple, produisent énormément mais n’ont pas forcément la capacité d’envoyer plusieurs tonnes au port du Havre ou de Rotterdam. Donc le PCC les met en relation, contre argent ou service rendu, avec des logisticiens capables de faire passer la coke dans les ports européens, ou avec des mafias comme la ‘Ndrangheta italienne ou les mafias des Balkans qui veulent commander chez les Colombiens. Mais il régule aussi les prix, sécurise les cargaisons et redistribue les profits », décrypte le spécialiste de la criminalité internationale.
À l’inverse du modèle « Scarface » à la Pablo Escobar dans les années 1980-1990, pyramidal et centré sur un baron de la drogue, le PCC brésilien a une structure « horizontale, réticulaire, où chaque maillon connaît uniquement le précédent et le suivant, ce qui rend la chaîne difficile à tracer », souligne Victor Simoni.
À Sao Paulo, un graffiti «PCC» pour Primeiro Commando da Capital, un groupe brésilien devenu un acteur clé du trafic de cocaïne. AP – Nelson Antoine
Une méthode très efficace économiquement également : le PCC a réussi à diversifier les routes du trafic et à offrir une cocaïne plus pure et moins chère sur les marchés de détail. Face à la guerre menée à la drogue en Amérique du Nord, les trafiquants se tournent vers des marchés moins sous pression au mitan des années 2010, à savoir l’Europe. Aujourd’hui, affirme le chercheur qui a étudié les saisies au port du Havre, « la majorité des vagues de coke arrivant en Europe est orchestrée par le PCC ». Le rapport Filières atlantiques : le PCC et le commerce atlantique entre le Brésil et l’Afrique de l’Ouest de Global Initiative en 2023 faisait aussi le lien entre le PCC brésilien et le développement des flux vers l’Afrique de l’Ouest comme étape de transit vers l’Europe.
Selon les experts, le PCC est devenu l’un des principaux acteurs transnationaux de l’exportation de cocaïne, orchestrant une partie importante des flux vers l’Europe et les marchés secondaires. Cela n’empêche pas d’autres organisations, comme les cartels mexicains de Sinaloa et Jalisco, de conserver un rôle central, dans l’accès au marché nord-américain en particulier. Elles restent des acteurs de poids dans l’exportation, même si elles passent parfois par « l’intermédiation » du PCC. « Il semble qu’il y ait une entente mondiale entre les grands groupes criminels, commente Victor Simoni : tout le monde a compris que la violence nuit au trafic et à la rentabilité, et qu’il vaut mieux collaborer. »
S’il est difficile d’estimer le marché de la cocaïne, la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) avançait dans une audition publiée dans un rapport sénatorial* de 2024, que « tant que l’on n’atteint pas un niveau de saisie entre 70% et 90% de la production, on ne “mord” pas sur le modèle économique ».
Une distribution fragmentée
« La logistique criminelle mondiale actuelle relie une plus grande variété de producteurs et de détaillants, garantissant un marché sans monopole ni monopsone, même si très peu de groupes criminels transnationaux contrôlent le centre de la chaîne de valeur », analysent Nicolas Lien et Gabriel Feltran dans un article publié en 2025 dans le Journal of Illicit Economies and Development. « La chaîne reste diverse, et aux côtés des gros acteurs, on retrouve des trafiquants européens qui commandent directement au Pérou, et de petits groupes qui achètent 10 ou 15 kilos pour faire passer en métropole », précise Laurent Laniel.
Si le maillon central de l’exportation à grande échelle est dominé par le PCC, la distribution finale de la cocaïne en Europe et ailleurs est très éclatée. Dans les ports européens, principaux points d’arrivée de la drogue, la marchandise est réceptionnée par des groupes bien implantés localement, que ce soit des mafias historiques, comme la ‘Ndrangheta italienne, les nouveaux réseaux albanais et balkaniques, ou les groupes criminels marocains ou encore espagnols. Rotterdam, Anvers, Hambourg, Le Havre, Valence ou Barcelone figurent parmi les principaux ports d’entrée du continent. Au total, 419 tonnes ont été saisies en 2023, selon le dernier rapport de l’EUDA. Europol note que pour une tonne saisie, plusieurs autres passent entre les mailles du filet. Logiquement, plus on descend dans la chaîne jusqu’au dealer de quartiers, plus la fragmentation s’accentue. Un modèle qui permet une plus grande résilience : en cas de coups de filet ou de saisies, le marché se recompose très vite.
De nombreux intermédiaires locaux sont d’ailleurs payés en cocaïne, ce qui alimente l’émergence de nouveaux marchés de consommation, notamment en Afrique de l’Ouest, mais aussi dans certains ports européens. Après une saisie au port de Valence, une partie de la cargaison s’est retrouvée sur le marché local, revendue par des dockers corrompus.
RFI