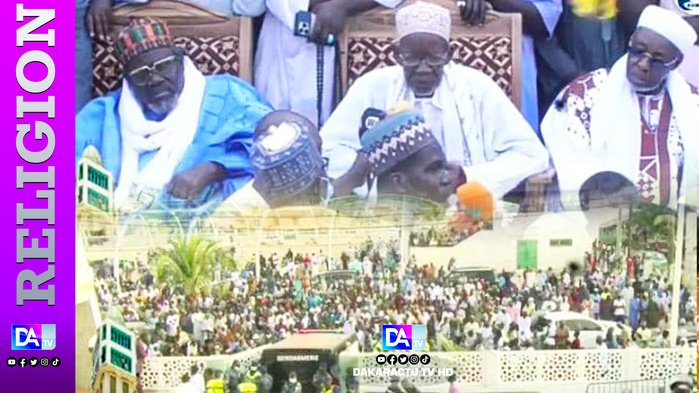C’est à l’issue de trois tours de scrutin seulement que le Mauritanien Sidi Ould Tah a été élu président de la Banque africaine de développement (BAD), avec 76,18 % des voix. Il devient ainsi le neuvième président de l’institution panafricaine pour un mandat de cinq ans.
Le processus électoral, bien que serré en amont, s’est accéléré au fil des tours. Le Tchadien Mahamat Abbas Tolli a été le premier éliminé avec seulement 0,88 % des suffrages, suivi de la Sud-Africaine Swazi Tshabalala, qui a quitté la course après avoir recueilli 5,9 %. Dès le deuxième tour, Sidi Ould Tah avait pris une avance décisive, obtenant les deux tiers des votes des pays africains, un soutien régional massif. Il a ensuite confirmé sa position au troisième tour, devançant largement le Zambien Samuel Maimbo (20,26 %) et le Sénégalais Amadou Hott (3,55 %), dont les espoirs se sont effondrés.
Une élection bien orchestrée, entre réseaux diplomatiques et stratégie de fond
Dernier à se déclarer candidat, Sidi Ould Tah a mené une campagne courte mais remarquablement efficace. Il a pu compter sur le soutien diplomatique de son pays, la Mauritanie, alors que le président Mohamed Ould Ghazouani assurait la présidence de l’Union africaine en 2024. Mais c’est surtout l’appui des pays arabes, via les réseaux d’influence de l’Arabie saoudite, qui a été décisif, permettant de rallier les voix de plusieurs membres non africains influents.
Sa posture de pont entre l’Afrique et le monde arabe a séduit de nombreux actionnaires. Fort de son expérience à la tête de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (Badea), dont il a dirigé la transformation en une institution de financement majeure, Sidi Ould Tah a démontré sa capacité à mobiliser des capitaux, à structurer des projets ambitieux et à faire dialoguer deux sphères économiques longtemps cloisonnées.
Une vision pragmatique pour une BAD à la croisée des chemins
Le nouveau président hérite d’une stratégie décennale (2024–2033) articulée autour des High 5 définis par son prédécesseur nigérian Akinwumi Adesina : nourrir, éclairer, intégrer, industrialiser le continent et améliorer la qualité de vie des Africains. Une feuille de route ambitieuse, que Sidi Ould Tah entend bien revisiter à l’aune de ses priorités.
« Les High 5 répondent aux préoccupations de l’Afrique. Certaines initiatives comme Mission 300 ou Desert to Power sont importantes. Il est fondamental de bâtir sur les succès de ses prédécesseurs. Mais la BAD peut faire mieux et doit faire plus », déclarait-il durant sa campagne.
Avec l’aide de Frannie Leautier, ancienne vice-présidente de la BAD et de la Banque mondiale, qui a dirigé son équipe de campagne, le nouveau président a défini un programme structuré autour de quatre axes majeurs, baptisé « Les quatre points cardinaux » :
Un profil discret, mais stratège
Connu pour sa réserve, Sidi Ould Tah tranche avec le style flamboyant d’Adesina. Son élection marque une volonté de retour à une présidence plus consensuelle, mais pas moins ambitieuse. Le message qu’il porte est clair : l’aide occidentale traditionnelle est en déclin, l’Afrique doit trouver les financements là où ils se trouvent.
« Le monde de l’aide au développement financée par l’Occident est mort, il faut l’accepter », analyse Serge Ekué, président de la BOAD. « Le docteur Sidi Ould Tah est le mieux placé pour convaincre les pays membres de la coordination arabe de choisir l’Afrique. Ils ont des centaines de milliards à investir, et il les connaît comme sa poche. »
Un nouveau cap pour la BAD
Le défi est immense : la BAD doit continuer à jouer un rôle central dans le financement du développement africain, alors que les besoins du continent s’intensifient qu’il s’agisse d’infrastructures, d’énergie, d’agriculture ou d’innovation.
Reste à savoir si Sidi Ould Tah parviendra à reproduire, à la tête de la BAD, la réussite qu’il a connue à la Badea. Son élection, incontestable par son ampleur, laisse entrevoir un repositionnement stratégique de l’institution vers une Afrique plus souveraine, mieux financée, et résolument tournée vers ses partenariats naturels.