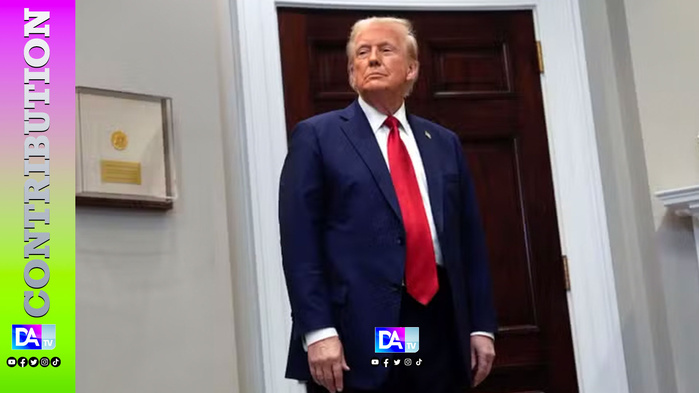Le Pentagone examine plusieurs scénarios d’action militaire au Nigeria à la suite d’un ordre donné par le président américain Donald Trump, qui affirme vouloir « protéger les chrétiens » face aux violences de groupes islamistes. L’information est rapportée par le New York Times, citant des responsables militaires.
D’abord, l’évidence. Même si le président Donald Trump a donné l’ordre au Pentagone de se préparer à intervenir militairement au Nigeria pour protéger les chrétiens contre les attaques de militants islamistes, les forces américaines sont peu susceptibles de parvenir à mettre fin à une insurrection qui dure depuis des décennies et qui a fait des victimes au sein de toutes les communautés confessionnelles du pays le plus peuplé d’Afrique, affirment des responsables militaires.
Selon eux, l’armée américaine ne pourra pas apaiser la violence sans s’engager dans une campagne comparable à celles d’Irak ou d’Afghanistan — une perspective que personne ne semble envisager sérieusement. Quelques options existent, toutefois, pour affaiblir les groupes armés, mais leur effet serait limité.
L’armée de l’air pourrait mener des frappes sur les quelques camps connus du nord du Nigeria qu’utilisent les groupes armés. Des drones américains comme le MQ-9 Reaper ou le MQ-1 Predator pourraient viser certains véhicules ou convois. Les forces américaines pourraient aussi coopérer avec l’armée nigériane pour mener des raids dans des villages où se cachent les insurgés.
A lire : Trump, Tinubu et les chrétiens du Nigeria : les raisons d’une nouvelle escalade
Ces propositions figurent parmi les scénarios élaborés cette semaine par le Commandement américain pour l’Afrique (Africom) et transmis à l’état-major du Pentagone. Elles font suite à l’annonce de Donald Trump, le week-end dernier, qui a menacé le Nigeria d’une action militaire pour mettre fin à ce qu’il a décrit comme des attaques contre les « CHERISHED Christians » (CHERS chrétiens). En réalité, la violence est davantage liée à des conflits fonciers qui ont fait des milliers de morts, musulmans et chrétiens.
« Ce serait un fiasco »
Des groupes armés comme Boko Haram ou l’État islamique en Afrique de l’Ouest (Iswap) ont bien pris pour cible des chrétiens, mais aussi des musulmans accusés d’être insuffisamment pieux. Mais une opération militaire d’envergure menée par Washington serait vouée à l’échec, estiment plusieurs responsables militaires américains.
« Ce serait un fiasco », a déclaré le général de division Paul D. Eaton, vétéran de la guerre d’Irak. Il souligne que l’opinion publique américaine n’a aucune envie de revivre une campagne du type Irak ou Afghanistan – pas plus sans doute que le président lui-même, qui ne semble pas aller au-delà de ses messages sur les réseaux sociaux.
Même une campagne de frappes aériennes ciblées — la méthode favorite de Donald Trump — ne produirait guère plus qu’un effet de stupeur et d’effroi, sans résultat durable, notent les experts militaires. Cela reviendrait à « frapper un oreiller », selon Paul D. Eaton.
Des responsables militaires et de la sécurité nationale, y compris parmi ceux qui sont familiers des combats contre les groupes islamistes en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale, ont dit leur perplexité après la dernière directive présidentielle.
« J’ordonne par la présente à notre département de la Guerre de se préparer à une action possible », a écrit Donald Trump sur les réseaux sociaux le 1er novembre. Le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, a eu tôt fait de lui répondre, toujours sur les réseaux sociaux : « Yes, Sir ». Son bureau a immédiatement ordonné au Commandement pour l’Afrique d’envoyer des plans pour d’éventuelles frappes.
Trois options : légère, moyenne ou lourde
Basé à Stuttgart, en Allemagne, Africom a ressorti de ses archives des scénarios pour la région du Sahel et les a envoyés à Washington. Son nouveau chef, le général Dagvin R. M. Anderson, avait prévu de se rendre au Nigeria d’ici un mois environ. D’après trois responsables de la Défense, les plans comprennent trois options — légère, moyenne et lourde — conçues pour permettre une montée progressive en puissance.
L’option légère prévoit des opérations menées avec des partenaires locaux : Washington et le département d’État aideraient les forces nigérianes à traquer Boko Haram et d’autres groupes islamistes responsables d’attaques, d’enlèvements et de meurtres, surtout dans le nord du pays ravagé depuis près de vingt ans par des violences religieuses et ethniques. Les États-Unis devraient agir sans l’appui de l’agence américaine Usaid, dont le bureau d’Abuja a fermé en juillet, sur décision de l’administration Trump.
Cette approche soulèverait toutefois de nombreuses difficultés. La violence dans le nord du Nigeria est profondément enracinée dans des rivalités culturelles, linguistiques et religieuses, souvent liées à l’usage des terres et aggravées par la corruption du pouvoir central. Les affrontements récurrents entre agriculteurs et éleveurs ont favorisé l’implantation des groupes jihadistes, qui exploitent la méfiance pour imposer leur idéologie.
Boko Haram, notamment, a ciblé aussi bien des chrétiens que des musulmans. Les précédentes administrations américaines avaient apporté un soutien en matière de renseignement et de sécurité au Nigeria, mais avaient refusé de lui vendre certaines armes en raison des accusations de violations des droits humains portées contre son armée.
L’option moyenne consisterait à mener des frappes de drones sur des camps, bases, convois et véhicules dans le nord du pays. Les drones Predator et Reaper peuvent survoler une zone pendant des heures avant d’attaquer, tandis que le renseignement américain analyse les habitudes des cibles.
Plus de bases au Niger
Mais là encore, des obstacles existent : les États-Unis ont quitté en août leurs deux bases de drones les plus proches, à Agadez et Niamey, au Niger — désormais occupées par des forces russes. Jusqu’à récemment, les drones pouvaient atteindre le Nigeria en une heure à partir de ces bases. Aujourd’hui, les sites américains les plus proches sont situés soit dans le sud de l’Europe, soit à Djibouti.
Un responsable américain suggère que certains pays d’Afrique de l’Ouest pourraient offrir d’accueillir les drones pour plaire à Washington, mais cela semble bien incertain — et risquerait de froisser Abuja, dont le poids est considérable sur le continent.
Le gouvernement nigérian s’est dit ouvert à une coopération avec les États-Unis contre les insurgés islamistes, tout en exigeant le respect de sa souveraineté et de son intégrité territoriale.
Enfin, l’option lourde impliquerait le déploiement d’un groupe aéronaval américain dans le golfe de Guinée, avec des chasseurs et éventuellement des bombardiers à long rayon d’action pour frapper en profondeur le nord du Nigeria.
Mais le porte-avions Gerald R. Ford est déjà en cours de redéploiement, des eaux européennes vers les Caraïbes, où Trump a déclaré la guerre aux cartels de la drogue. Les autres bâtiments sont engagés ailleurs, dans le Pacifique ou au Moyen-Orient, ou sont en cours de maintenance. Déployer un porte-avions américain dans le golfe de Guinée pour affronter des insurgés islamistes au Nigeria n’était pas considéré comme une priorité de sécurité nationale pour 2025, ont déclaré plusieurs responsables militaires. Du moins jusqu’à la semaine dernière.
Par Helene Cooper
© 2025 The New York Times Company